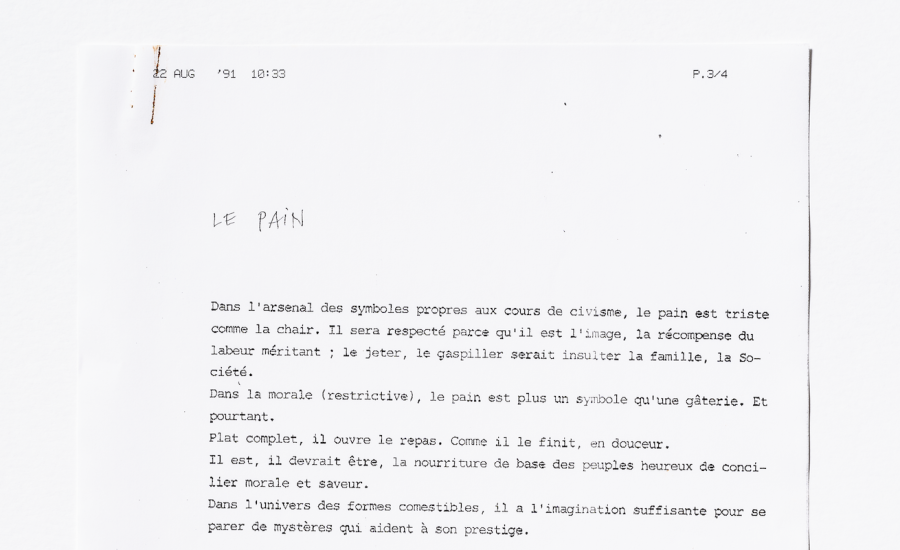À parcourir l’inventaire du fonds Pol Bury, l’œil est souvent arrêté par des incipits particulièrement piquants pour la curiosité. En voici un : « J’aime le boudin dans l’assiette parce qu’il y exprime, impitoyablement, la conscience des terreurs… » A-t-on envie de lire la suite ? On demande 268BRY/13/23, et, en ouvrant la chemise cartonnée, l’on découvre une suite de 17 feuillets manuscrits qui ne voient que bien rarement le jour. Mais ces dossiers, petits tombeaux provisoires, abritent autant de Lazare qui se lèvent de feuille en feuille pour faire émerger quelque chose qui est de l’ordre du vivant. Il y a l’encre et le papier, il y a les mots et la main de celui qui les a tracés, il y a ce qui est écrit — et les fils que l’on peut tirer de ce tissu se mettent à vibrer dans toutes sortes de directions. Au fond, on consulte les archives un peu comme les tables tournantes. Quand « l’esprit est là », on oublie vite où l’on est et le temps qu’il fait dehors.
Il y d’autant plus de vie enfermée dans le millefeuille 13/23 qu’il y est question de nourriture. Quelques souvenirs se présentent, pêle-mêle : on songe aux banquets organisés par le Daily-Bul, à un texte de Bury sur l’endive, au chicon qui le symbolise dans un tract publié 12 ans plus tard… et déjà l’on s’arrête, car des liens s’établissent entre les premiers éléments de cette énumération, avec toute l’épaisseur du temps — presque un lustre — qui vient faire gonfler notre millefeuille.
Pour commencer, un certain banquet : en 1953, lors d’un dîner apprêté pour les 50 ans d’E. L. T. Mesens, André Balthazar et Pol Bury avaient glissé sous les serviettes, dans un geste d’humour bon enfant, un petit papier sur lequel était imprimée une vignette représentant deux pipes entrecroisées, avec pour légende « Ça est deux pipes ». Vexé, Magritte avait aussitôt quitté les lieux avec fracas. Il faut préciser qu’à l’époque, celui-ci en voulait à Pol Bury d’avoir abandonné la peinture surréaliste, et n’était guère en humeur de supporter la moindre plaisanterie de sa part. Bien des années plus tard, en 1986, est organisée une exposition rétrospective de Pol Bury au Botanique de Bruxelles ; la préface que rédige l’artiste pour le pseudo-catalogue — en réalité mi-autobiographie, mi-journal de bord — est exclusivement consacrée à l’éloge de l’endive qui fut inventée dans les caves du lieu : « Légume souterrain vivant en couches successives, comme d’anciens mineurs d’anciens Borinages, il acquiert dans les sous-sols la blancheur du jour : cinglante contradiction d’une logique supérieure […] Et qui dira, de la mollesse tendre des feuilles peu cuites à leur caramélisation, les circonspections du chicon et ses tergiversations avec le feu ? » Comprenne qui voudra, conclut l’auteur avec désinvolture, le rapport de ces propos avec l’exposition qu’ils sont supposés présenter. Les années passent. En 1998, au même endroit, prend place une rétrospective Magritte ; pendant le repas organisé pour l’inauguration, André Balthazar et Pol Bury font circuler les deux derniers numéros de leurs tracts intitulés Les Curés exagèrent (5e et 6e degrés). L’un, illustré de deux pipes — « Ça est (toujours) deux pipes » — réfère évidemment à Magritte, tandis que le chicon figurant en vignette sur l’autre — « Ça est toujours un witloof » — désigne Pol Bury en rappelant son exposition passée au Botanique. Les deux tracts, l’un déplorant l’usage des tuyaux de pipe pour faire des bulles, l’autre s’indignant de ce que le menu du jour ne comporte pas de « chicon à la moutarde », sont signés de tous les pseudonymes ayant eu cours dans les numéros successifs de la revue Daily-Bul.
Mais cette rêverie nous a éloignés du boudin et des « terreurs » qu’il inspire. Voici la version définitive du texte, tel qu’il a été publié ultérieurement :
« Le boudin exprime impitoyablement dans l’assiette la conscience des terreurs de notre époque : l’image d’un monde semblant appartenir à un temps antérieur à l’homme, et que nous contemplons avec épouvante et répulsion.
En lui-même, le boudin n’a rien à voir avec la réalité ; il est semblable à l’image de nos rêves les plus sauvages. Mais c’est l’exactitude rigoureuse avec laquelle il est fabriqué qui communique si vivement au spectateur la menace très réelle dont il est chargé. »
Ce texte figure dans une série consacrée à des aliments : « L’artichaut », « Les sauces », « La tarte », « La mayonnaise », « Le boudin », « Le camembert », « La frite », « La nouille », « La saucisse », « L’œuf dur » et « Le saucisson », textes qui pour la plupart ont été publiés en 1998 parmi les entrées du « Petit glossaire à usages divers » dans Le Daily-Bul : Quarante balais et quelques et, plus tard, dans la revue d’artiste Simili-Type n° IV : « La bouffe », imprimée sur les presses de Serg Gicquel et Isa Slivance en 2003. Ces savoureuses « notices » sont référencées comme ayant été composées pour l’exposition D’un art Bul à l’autre, organisée à Paris en 1982. Encore un fil à suivre dans l’inextricable pelote du Daily-Bul, lequel pratique une intertextualité interne d’une manière aussi effrénée que jubilatoire !
Une autre destination semble avoir été provisoirement envisagée pour ces textes, ceux-ci devant être placés à la suite des « Fables » d’Esthétiques galopantes. L’auteur s’en est finalement abstenu, mais ce contexte initialement prévu permet de mieux comprendre ces curiosa : la référence plus ou moins narquoise à l’art ou à la peinture doit y être subodorée. Ainsi, quel peut être ce monde redoutable qui, surgi de la vision du boudin dans l’assiette, semble « appartenir à un temps antérieur à l’homme » et suscite « l’image de nos rêves les plus sauvages » ? — Sans doute l’époque de la peinture pariétale, dont les ingrédients rappellent ceux du mets en question : les pigments tirés de la nature n’étaient-ils pas broyés puis dilués avec des graisses animales et du sang ? Car, la suite du texte le montre, c’est bien la recette du boudin qui révèle « la menace très réelle dont il est chargé ».
Or c’est au présent qu’est dénoncée cette menace, et la préhistoire n’est ici évoquée que pour mieux ravaler à l’âge des cavernes un mouvement d’art contemporain qui fait frémir notre auteur : l’art corporel et sa fascination pour la douleur et la dramaturgie du sang. Dans Les Gaietés de l’esthétique, sorte de dictionnaire satirique consacré à l’art et à ses dérives, figure une épigramme à l’entrée « Boudin » concernant Michel Journiac et sa « Messe pour un corps », performance au cours de laquelle celui-ci a fait communier l’assistance avec des rondelles de boudin cuisiné avec son propre sang. La recette de cette hostie provocatrice, établie avec la plus « rigoureuse exactitude » par l’artiste-célébrant, est citée non sans malice par Pol Bury : « Prendre 90 cm3 de sang humain liquide (le contenu de trois seringues grand modèle) ; 90 g de gras animal ; 90 g d'oignons ; un boyau salé, ramolli à l'eau froide puis épongé ; 8 g de sel ; 5 g de quatre-épices ; 2 g d'aromates et de sucre en poudre. » Si la tonalité du contexte est ironique et désinvolte, cette citation, figurant en note en bas de page, suffit à remplacer tout développement argumentatif par un geste à la Hypéride, sauf qu’au lieu de susciter l’admiration à la vue de la beauté de Phryné, il ne déclenche que le dégoût le plus instinctif devant ce précipité de cannibalisme.
Pol Bury nous sert donc une bien étrange cuisine dans ce dossier alimentaire truffé d’allusions plus ou moins cryptées, où il souligne « l’apport essentiel à la “texturologie” » du saucisson — par référence évidente à Dubuffet — ou traite les sauces de monochromes qui ne disent que ce qu’ils sont, dans une sorte d’infinie « tautologie ». Mais rien d’étonnant, pour finir, à ce que la métaphore culinaire vienne si souvent sous sa plume, lui qui suivait un « régime Montignac » et cuisait, presque tous les jours, son propre pain.
Frédérique Martin-Scherrer